CW dans les extraits cités : hétérocentrisme, cissexisme, transphobie, enbyphobie
Tout est parti d’une conférence TEDxEuston. Comme elle le rapporte au début de son livre, Chimamanda Ngozi Adichie (C.N.A.), écrivaine nigériane et d’expression anglaise, est invitée en décembre 2012 à parler dans le cadre d’une conférence consacrée à l’Afrique. Elle choisit d’aborder le sujet du féminisme, à travers le prisme des stéréotypes de genre. Filmée, cette intervention connut un succès phénoménal, au point que Beyoncé en a samplé un extrait dans sa chanson « Flawless ». C.N.A. a retranscrit le texte et en a fait un petit livre, publié en 2014 et traduit depuis dans de nombreuses langues.
Avant de parler du contenu, je voudrais revenir sur la couverture d’une des éditions françaises :
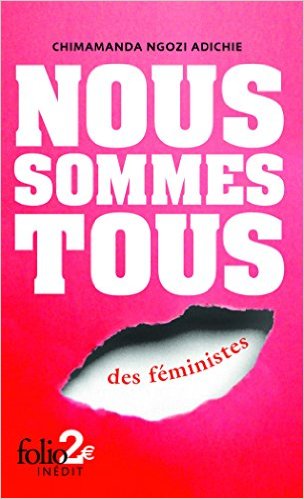
On y voit le titre, écrit en gros et en blanc sur un fond rouge rosé. La fin du titre, « des féministes », est écrite en beaucoup plus petit, à l’intérieur de ce qui évoque une trace de rouge à lèvres : des lèvres, charnues, féminines. Féminisme glamour. Chouette.
Si les couvertures des autres éditions sont beaucoup moins suggestives, la couverture française a le don de m’énerver. Oui, C.N.A. aime porter du gloss et des talons aiguilles. Libre à elle d’en porter tous les jours si elle le souhaite, le problème n’est bien sûr pas là. Mais cela donne d’emblée l’impression qu’on nous présente un féminisme « gentil » : un féminisme prôné exclusivement par des femmes qui se maquillent. Pas si dangereuses, donc. Et si, effectivement, ce petit livre n’est ni méchant ni révolutionnaire, il a le mérite de rendre le sexisme (et, a fortiori, le féminisme) accessible à tou·te·s, tout en comportant quelques défauts non négligeables.
Le sexisme, fléau systémique mis en évidence
Le livre alterne exemples tirés de sa vie personnelle et de celle de ses ami·e·s, et réflexions élargies à l’ensemble de la société, les premiers servant de point de départ aux secondes. Prenons la première anecdote citée : à l’école, l’élève qui obtient le meilleur score à un test devient chef de classe. La petite Chimamanda obtient le score plus élevé, mais le titre est décerné à un garçon, qui a obtenu le deuxième meilleur résultat. Pourquoi une telle décision ? Les filles ne peuvent tout simplement pas être chef de classe. Afin de montrer à quel point la décision était sexiste, C.N.A. nous donne un détail supplémentaire : le petit garçon en question n’éprouvait aucune envie de devenir chef de classe et d’obtenir le pouvoir qui allait avec – contrairement à la petite Chimamanda de l’époque.
De cette anecdote, C.N.A. tire une réflexion globale : « Si nous répétons sans cesse la même action, elle devient normale. Si vous voyons sans cesse la même chose, elle devient normale. Si seuls les garçons deviennent chefs de classe, alors à un moment donné on pensera, même inconsciemment, que le chef de classe doit être un garçon. Si nous continuons à voir seulement des hommes devenir PDG, on commence à trouver ça « naturel » qu’il n’y ait que des hommes PDG ». La comparaison entre le statut de chef de classe et celui de PDG permet de souligner l’influence d’une éducation sexiste sur les enfants : habituées dès leur plus jeune âge à se dévaluer et à ne pas (trop) se mettre en avant, les petites filles sont finalement éduquées à ne pas avoir d’ambitions professionnelles. L’éducation explique donc en partie la – quasi – absence de femmes à la tête de grandes entreprises. Prenons l’exemple de la France : selon le rapport 2016 de l’Observatoire de Skema sur la féminisation des entreprises, les femmes représentent 47,82 % de la population active, mais 30,34 % des postes d’encadrement, et elles ne sont plus que 11,24 % à siéger dans les comités de direction des grandes entreprises.
Grâce à cette méthode (exemples puis généralisation), C.N.A. met en avant plusieurs facettes du sexisme, ce qui permet de montrer qu’il s’agit d’une oppression systémique touchant tous les domaines de la vie.
Petit tour d’horizon : étant une femme, elle ne peut pas se rendre seule dans des boîtes de nuit nigérianes ; au restaurant, le·a serveur·se ne s’adresse qu’aux hommes qui se trouvent avec elle ; lorsqu’elle donne un pourboire, on remercie l’homme qui l’accompagne, pas elle.
À propos de la discrimination au travail, elle donne l’exemple d’une amie qui, pour mener la même politique de management que son prédécesseur, est taxée d’agressivité – parce qu’elle est une femme et donc censée apporter une touche « féminine » à ce poste. Elle aborde également la question de l’ambition, et la manière dont les jeunes filles sont éduquées de telle façon qu’arrivées à l’âge adulte, elles ont intériorisé une infériorité certaine, qui les conduit à avoir moins d’ambitions que les hommes et à se tenir en retrait : « Les femmes n’ont qu’à refuser cet état de fait – c’est facile à dire, mais la réalité est plus coriace et plus complexe. Nous sommes des êtres sociaux. Nous intériorisons les idées de notre environnement ».
Elle aborde également la question de la culture du viol – sans cependant la nommer : « Nous apprenons à nos filles que leur sexualité n’est pas comparable à celle des garçons. Si nous avons des fils, nous ne nous formalisons pas de les entendre évoquer leurs petites amies. Mais les petits amis de nos filles, Dieu nous en garde ! […] Nous apprenons la honte à nos filles. Croise les jambes. Couvre-toi. Nous les persuadons qu’elles sont coupables simplement parce qu’elles sont de sexe féminin. ». Cet exemple permet d’illustrer le processus d’intériorisation de normes arbitraires et sexistes : à force de dire aux femmes que c’est forcément un peu de leur faute si elles sont violées, elles finissent par l’intérioriser. En plus de culpabiliser les victimes, cela dédouane également en partie les violeurs qui, dans le cadre de cette culture du viol, bénéficient d’une complaisance certaine.
Elle s’intéresse enfin à la répartition des tâches dans la sphère privée : « Je connais une femme qui a le même diplôme et le même poste que son mari. À la fin d’une journée de travail, c’est elle qui assume presque toutes les corvées à la maison – ce qui est le cas dans la plupart des mariages. Ce qui m’a frappée, c’est que chaque fois qu’il changeait les couches du bébé, elle le remerciait. Et si elle trouvait normal et naturel qu’il s’occupe lui aussi de l’enfant ? ». Elle soulève ici un point qui, s’il n’est pas développé, est aussi intéressant que répandu, et fait partie de la charge mentale, second concept féministe abordé dans cet ouvrage après la culture du viol.

Répondre aux reproches adressés au féminisme actuel
Une autre qualité de ce petit livre est de répondre de manière simple et pertinente à quelques critiques récurrentes auquel le féminisme actuel – parce que méconnu et trop vite jugé – doit sans cesse faire face.
C.N.A. commence par s’attaquer aux clichés qui collent à la peau des féministes, parmi lesquelles elle se compte : « On déteste les hommes, on déteste les soutiens-gorges, […] on n’a aucun sens de l’humour, on ne met pas de déodorant ». C.N.A. décide alors de se définir ainsi : « J’ai donc décidé d’être désormais une Féministe Africaine Heureuse qui ne déteste pas les hommes, qui aime mettre du brillant à lèvres et des talons hauts pour son plaisir, non pour séduire les hommes. » Si l’autrice ne parle pas explicitement d’un féminisme pro-choix, c’est ce qui apparaît en filigrane : une féministe est une féministe, peu importe son apparence, ce sont ses convictions qui comptent. Elle refuse de se conformer aux clichés évoqués plus haut, et prouve ainsi qu’il n’y a pas une façon d’être féministe (surtout en ce qui concerne l’apparence).
Elle s’attaque ensuite à des arguments de fonds : « ‘Je ne vois pas ce que tu veux dire en affirmant que les choses sont différentes et plus difficiles pour les femmes. C’était peut-être le cas dans le passé, mais plus maintenant. Tout va bien maintenant pour les femmes.’ Je ne comprenais pas comment Louis pouvait ne pas voir ce qui me semblait si évident ». Elle raconte qu’un ami à elle, Louis, estime que le féminisme est désuet. Aujourd’hui, tout va bien, non ? En rapportant les propos de son ami, l’autrice dénonce une pensée – trop – répandue : aujourd’hui, beaucoup de gens pensent que notre monde n’a plus besoin du féminisme. Naïveté ou refus de voir les inégalités toujours bien ancrées dans notre société ? Sûrement un peu des deux. En effet, les personnes qui ne sont pas concernées par le sexisme ignorent souvent soit l’existence de cette oppression, soit l’omniprésence et la prégnance de celle-ci. Il s’agit donc de naïveté, teintée de méconnaissance. Mais il s’agit également d’une façon de se voiler la face : il est facile et confortable d’ignorer l’existence d’une oppression lorsqu’on n’est pas concerné·e par celle-ci, et de faire comme si de rien n’était.
Un autre reproche fait aux féministes, un peu plus vicieux à mon sens, consiste à vouloir parler d’humanisme plutôt que de féminisme. C.N.A. démonte cet argument en quelques phrases : « [ …] ce serait malhonnête. Le féminisme fait à l’évidence partie intégrante des droits de l’homme, mais se limiter à cette vague expression […] serait nier le problème particulier du genre. Ce serait une manière d’affirmer que les femmes n’ont pas souffert d’exclusion pendant des siècles. » Comme elle l’explique brièvement, il est important de nommer précisément la lutte dans laquelle on est investi·e. Parler d’humanisme serait nier l’oppression spécifique dont les femmes – et les personnes perçues comme femmes par la société – sont victimes. Tout comme parler de lutte contre les discriminations pour parler de la lutte contre les LGBT+-phobies serait une façon d’invisibiliser les spécificités de ces oppressions. Il faut néanmoins préciser – ce que C.N.A. ne fait pas –, que le féminisme doit aujourd’hui être compris de façon assez large. Dans la mesure où il est inclusif, il ne concerne et ne s’adresse pas qu’aux femmes, mais également aux personnes LGBT+, racisées, non valides, etc.
Un féminisme qui cède aux facilités de l’essentialisme et d’une critique toute relative
Le plus gros défaut de ce petit livre consiste à ne jamais s’affranchir du modèle de notre société, et donc à ne pas s’affranchir de l’essentialisme, du cissexisme et de l’hétérocentrisme ambiants. Ce défaut m’a sauté aux yeux dès les premières pages, et est présent jusqu’à la fin de l’ouvrage.
Dès le début, le ton est donné : « Les hommes et les femmes sont différents. Nous n’avons ni les mêmes hormones, ni les mêmes organes génitaux, ni les mêmes capacités biologiques – les femmes peuvent avoir des enfants, les hommes non ». En ne les citant pas, C.N.A. invisibilise toutes les personnes qui ne rentrent pas dans ce schéma social artificiel : les personnes trans*, non-binaires, intersexes, etc. Si, des hommes peuvent être enceints, et d’ailleurs, des personnes qui ne sont ni homme ni femme peuvent également être enceintes. Rajoutons à cela l’invisibilisation de toutes les orientations romantico-sexuelles qui ne sont pas hétéros : pas une seule mention de l’homosexualité – sans parler de la bisexualité, de l’asexualité, etc. – comme si cela n’existait pas.
Mais, me direz-vous, il s’agit d’un ouvrage destiné à celleux qui n’ont jamais entendu parler de féminisme ou qui n’ont que des préjugés à propos de la lutte féministe. Pas à des militant·e·s. Il faut donc y aller par étapes. On ne peut pas intégrer du même coup des dizaines de mots nouveaux, des concepts jusque là inconnus, et sortir du modèle hétéro-cis-centré de notre société.
Certes. Mais on peut également écrire un ouvrage d’introduction au féminisme sans tomber dans la discrimination. Parce que c’est bien de discrimination qu’il s’agit. Faire comme si des personnes n’existaient pas, parce qu’elles ne rentrent pas dans le cadre qu’on connaît, c’est de la discrimination. Avec des phrases en apparence innocentes, C.N.A. contribue à la perpétuation des stéréotypes de genre : « Les différences biologiques entre garçons et filles sont incontestables, mais la société les exacerbe » ; alors même qu’elle souhaite la fin de ces stéréotypes qu’elle condamne par ailleurs.
En ce sens, le féminisme qu’elle prône n’est pas révolutionnaire, mais réformiste. Il n’est pas question de sortir du système genré ni donc d’abolir la notion de genre telle qu’elle est globalement répandue de nos jours. Il est question de créer une égalité entre les genres, et plus précisément entre les deux genres qu’elle reconnaît et qui sont acceptés par la société. Lorsqu’elle écrit : « Nous avons évolué. Mais notre conception du genre n’a pas beaucoup évolué », elle a tout à fait raison. Au point que ce constat s’applique même à elle : même elle, femme accomplie, cultivée et féministe, n’arrive pas à penser en dehors d’un système genré à outrance.
Pour terminer, soulevons un dernier point problématique : la place des hommes cis dans le féminisme d’après l’autrice. Lorsqu’il s’agit de sexisme, les hommes cis peuvent occuper une place d’allié, qui consiste à rester en retrait, à se taire la plupart du temps, à écouter et à apprendre. Il en va de même pour la lutte contre l’homophobie et la biphobie par exemple : les personnes hétéros sont invitées à se taire et à apprendre. Il s’agit chaque fois d’une oppression qui n’est pas vécue, par les hommes cis, dans le premier cas, et par les hétéros dans le deuxième cas.
Les dernières lignes du livres sont assez étonnantes : « Le féministe le plus fervent que je connaisse, c’est mon frère Kene […]. Pour ma part, je considère comme féministe un homme ou une femme qui dit, oui, la question du genre telle qu’elle existe aujourd’hui pose problème et nous devons le régler, nous devons faire mieux. Tous autant que nous sommes, femmes et hommes. » Oui, les hommes peuvent participer au féminisme. Oui, ils peuvent aider à faire bouger les choses. Mais ce n’est pas leur combat, et ils ne doivent pas y occuper une place trop importante – ils prennent déjà beaucoup – trop – de place dans la société.
En somme, ce petit livre est une bonne introduction au féminisme, disons, classique. Il met en évidence les stéréotypes et discriminations de genre qui existent encore aujourd’hui dans notre société. Mais, en ne les citant pas, il nie l’existence des personnes qui ne sont pas hétéros, de celle qui ne sont pas cis, de celles qui, en fait, ne s’inscrivent pas dans la norme que l’autrice critique. Son geste est louable, mais j’aurais aimé que – sans pour autant en faire un livre de 300 pages – l’autrice écrive une introduction véritablement inclusive. On termine la lecture avec l’amer sentiment qu’elle a laissé en chemin un certain nombre de gens sur le bord de la route.



