Caroline et Laura se sont rencontrées lorsqu’elles étaient étudiantes. Un joli coup de foudre, qui les a menées à vivre et voyager l’une aux côtés de l’autre, puis à désirer un enfant ensemble. La formation du désir de parentalité, le voyage de PMA (Procréation Médicalement Assistée) en Espagne, le poids de l’illégalité en France et la marginalisation des familles de couples homosexuels, tant de sujets que nous avons abordés autour d’une conversation retraçant leur histoire.
Cet article a été écrit avant l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi bioéthique en deuxième lecture. Le texte autorise notamment l'ouverture de la PMA à toutes les femmes.
Un projet qui se construit dans la durée
L’apparition du désir de parentalité et la construction de la maternité
Caroline et Laura ont toujours voulu être mères. Lorsque Laura s’imaginait porter un enfant avec évidence, Caroline ne souhaitait pas tomber enceinte et envisageait davantage l’adoption. Elles en avaient parlé, sans pour autant s’attarder sur le sujet. Elles étaient encore jeunes. Mais leur projet prit un nouveau tournant au cours de la 23e année de Laura. Suite à un rendez-vous médical, elle réalisa à quel point ses problèmes de santé pouvaient impacter sa maternité. Si elle voulait un enfant, il fallait agir vite. Le temps lui était compté, et sa conception serait obligatoirement médicalisée. Drainée par son désir de maternité, Laura comprit immédiatement qu’elle ne laisserait pas passer sa chance : « Je ne savais pas par quel bout commencer, ni comment on allait concevoir cet enfant. Je ne savais rien. Mais je savais que ma décision était prise, et que j’allais avoir un enfant, parce que c’était le moment et que je mettrai tout en ordre pour que ça fonctionne. »
Caroline désirait tout autant devenir mère, mais cette soudaineté entraina plusieurs inquiétudes, notamment celles d’être encore étudiante et de résider dans un petit appartement en ville. Le plus dur restait de trouver sa position en tant que maman : « J’appréhendais ma place de mère auprès de cet enfant. Je ne savais pas comment j’allais m’y retrouver. Afin de m’y préparer, j’ai lu, beaucoup. » D’un commun accord, il fut décidé que la naissance de l’enfant aurait lieu une fois le diplôme de Caroline décroché.
Grâce à ce temps d’attente, elles mirent en place un planning bien rodé, accumulèrent les conseils, réunirent les contacts de bons médecins et prirent rendez-vous en Espagne. À la faveur d’amies effectuant un parcours PMA, Caroline et Laura purent recueillir les recommandations, les avis et les difficultés rencontrées. Toutes ces démarches ouvraient doucement la voie à leur future parentalité. Comme me le raconte Laura, chacune trouvait ainsi sa place : « Malgré l’urgence, ce fonctionnement me convenait parce que j’avais l’impression de commencer le projet et de ne pas passer à côté des instructions médicales. Tandis que le rythme de Caro était, lui aussi, respecté. »
Un parcours de combattantes
Afin de comprendre pleinement le parcours du couple, il semble important d’expliquer le fonctionnement du protocole PMA. Ce dernier s’échelonne sur trois temps. Un accompagnement médicamenteux est d’abord proposé au couple pour favoriser la conception. Si cela ne fonctionne pas, on procède à des inséminations : le sperme du donneur est récupéré, puis inséminé à un moment précis du cycle menstruel. Ce procédé est accompagné d’un traitement médical. En dernier recours, on utilise la FIV (fécondation in vitro). Pendant plusieurs semaines, le corps destiné à recueillir l’embryon est stimulé et contrôlé. On y prélève ensuite des ovocytes en grand nombre, au cours d’une ponction la plupart du temps sous anesthésie générale. Les ovocytes sont placés dans une éprouvette avec le sperme pour que les embryons puissent se former. On les laisse se développer en culture, puis on les réinjecte dans la cave utérine. Laura a directement procédé à la FIV, car ses soucis de santé ne lui permettaient pas d’avoir recours aux deux premières options. Laura et Caroline ont dû se rendre trois fois en Espagne : pour l’inscription, pour la ponction et pour le transfert.
Le prix de la grossesse médicalement assistée
Dans un but d’implication mutuelle et d’égalité vis-à-vis de leur parentalité, il était primordial pour Caroline et Laura de partager toutes les dépenses liées au projet de maternité. Une somme importante, puisqu’elles ont payé environ 5000 euros uniquement pour la FIV. Le prix des trajets, de l’hébergement, des traitements et des examens augmentant encore d’un cran le colossal montant. Mais elles m’expliquent toutes deux qu’une fois l’argent déboursé, elles n’y pensaient plus. Ce point de vue n’empêche cependant pas la critique de la marchandisation des naissances. Leur étonnement eut lieu dès le premier appel passé à la clinique, dont le répondeur automatique ressemblait plus au service d’une agence de voyage qu’à celui d’un hôpital. Caroline témoigne : « On te demande directement quelle langue tu parles, et tu peux choisir entre cinq langues disponibles. Sous cet angle-là, c’est un vrai business, puisque une grande partie du personnel parle couramment espagnol, italien, français, anglais et allemand. »
Une fois sur place, Caroline et Laura m’expliquent avoir pris de plein fouet leur image fantasmée des hôpitaux pratiquant la PMA. Cette représentation faussée, nous l’avons toute·s, pour la simple et bonne raison que ce ne sont pas des hôpitaux. Ni infirmier·e, ni aide-soignant·e, ni chambre. Au lieu de ça, des bureaux propres et classieux, avec des salles d’attente pour chaque couple. Bonbons, machine à café, mini frigos, et tablettes sont à disposition. En revanche, la clinique n’assure aucune prise en charge supplémentaire. À la moindre complication, les couples doivent se tourner vers le droit commun.
Ces cliniques ont été construites autour d’une logique simple : pas d’argent, pas de bébé. Et comme la plupart des services payants, elles proposent des réductions. « Un échec ? Si vous tentez un essai supplémentaire, vous disposerez d’une réduction de 400 euros ! » Cette logique est poussée à son paroxysme dans les examens proposés aux client·e·s. S’iels payent les suppléments financiers conseillés, iels multiplient l’efficacité de leur PMA : « 500 € de plus, et vous pourrez observer vos embryons. Pour 600 €, nous vous proposons aussi un test de détection de mutations génétiques. » Ce fameux test a d’ailleurs posé de nombreuses questions au couple. Partagées entre le désir de vouloir le meilleur pour leur enfant, et celui de ne pas tomber dans l’eugénisme, Laura et Caroline se sont retrouvées face à une décision cruciale. Caroline me confie : « Ce test a pour but de détecter toutes les mutations génétiques qui sont possibles entre les ovules de la mère et le sperme du donneur. On a décidé de laisser le destin faire. Pour nous, c’était normal qu’il y ait une part de hasard, une part qu’on ne maîtrisait pas. Que personne ne pouvait maîtriser. Mais si tu vois ton enfant mourir à 16 ans d’une maladie génétique, est-ce que tu ne penses pas : « j’aurais dû payer ces 600 euros… » ? C’est tentant. Et iels te font culpabiliser, iels jouent sur l’émotion : « Vous êtes sûres de vouloir un enfant en bonne santé ? Payez ça ! » Réussir à poser ses limites dans cette sphère surmédicalisée, c’est parfois compliqué. » Quel parent ne serait pas tenté de tout faire pour éviter la maladie de son enfant ? Une logique que les cliniques semblent avoir efficacement intégrée. Cependant, ces dernières poussent à la sélection génétique dans une démarche pécuniaire. L’eugénisme est donc un choix politique que Caroline et Laura ont décidé de refuser.
Laura témoigne pourtant de son sentiment de gratitude à l’égard de telles structures : « Cet aspect business, je ne l’approuve pas éthiquement, mais on en a besoin pour arriver à nos fins. Sans cette clinique, on n’aurait pas pu avoir notre enfant. Donc j’ai fait abstraction, pour me concentrer sur le positif. »
Un rapport complexe se créée donc entre l’éthique bancale de la marchandisation et la maternité offerte par ces cliniques. Une représentation vacillant entre reconnaissance et regard critique.
Des bâtons législatifs dans les roues d’une famille naissante
Le protocole PMA, comparaison entre la France et l’Espagne
Les différences entre la PMA française et la PMA espagnole sont conséquentes et prennent de multiples formes. La France est beaucoup plus stricte en termes d’acceptation : nombre limité de tentatives, double don interdit, âge maximum restrictif et PMA autorisée uniquement aux couples… hétérosexuels. Ces quelques critères excluent d’office un grand nombre de projets de grossesse. L’Espagne autorise beaucoup plus de flexibilité, notamment des formes éloignées du schéma traditionnel du couple hétérosexuel. Il permet par exemple à une femme et deux hommes d’enfanter, à une femme seule d’avoir un enfant, ou à un couple de personnes stériles de pouvoir mettre au monde, ce qui est formellement impossible en France. Une inégalité fondamentale s’ajoute à la liste : le temps d’attente, démesurément long en France, qui augmente l’épuisement des couples. Laura me fait part des chiffres : « Sur les listes d’attente en France, le don d’ovocyte prend en moyenne trois ans. En Espagne, cela peut prendre 15 jours pour trouver la donneuse. »
L’Espagne a aussi un taux de réussite bien plus élevé qu’en France. Avec un protocole identique, deux femmes du même âge et répondant aux mêmes caractéristiques tomberont plus souvent enceintes en Espagne. Ce phénomène n’est pas le fruit du hasard, mais la résultante d’un système différent. D’une part, les stimulations sont plus puissantes d’un point de vue médical en Espagne. D’une autre, en France, le sperme et les ovocytes sont mis dans la même éprouvette, et on laisse les choses se faire toutes seules. En Espagne, systématiquement, les FIV pratiquées sont des FIV IMSI où les spermatozoïdes sont sélectionnés et introduits directement dans l’ovocyte. Cette technique existe en France mais n’est proposée que dans de rares cas d’échecs répétés.
Le poids de l’illégalité
Une PMA officialisée en France permet une ouverture de droits particulière à la sécurité sociale, comme par exemple la possibilité de prendre des rendez-vous médicaux sur le temps de travail ou la protection sociale. En effectuant leur PMA en Espagne, Laura et Caroline ne bénéficiaient d’aucun droit. De plus, la temporalité de la PMA exige une flexibilité démesurée. Une FIV nécessite une échographie ainsi qu’une prise de sang toutes les 48 heures, et ce sur plusieurs jours. Les résultats doivent ensuite être envoyés très rapidement en Espagne, mais le caractère illégal des démarches empêche la communication de ce type d’informations auprès des laboratoires d’analyse. En fonction des résultats d’examens, Laura devait être capable de prendre un traitement, puis de partir en Espagne sous 36 heures, sans jamais savoir au préalable quand le moment propice arriverait. Cette urgence de la ponction est difficile pour tous les couples qui suivent un parcours PMA. Mais ajoutez à cela une distance importante avec la clinique, et une absence de soutien du côté de la sphère professionnelle et juridique, elle devient un véritable parcours de la combattante.
Mais la logistique, Laura et Caro ont fait avec. Dans le fond, ce n’était « que » des efforts supplémentaires et la mise en place d’une organisation harassante. En revanche, les conséquences de l’illégalité ont été bien plus difficiles à gérer. Leur témoignage met en exergue un quotidien imprégné de cette épée de Damoclès : garder le secret. Pour se faire, toute une série de subterfuges se sont mis en place : changer fréquemment de pharmacie de quartier, utiliser des ordonnances variées afin que la raison du traitement ne soit pas flagrante, se rendre au laboratoire et à la pharmacie seule, devoir parler d’un mari de façon évasive lorsqu’on nous pose des questions à son sujet… Ne jamais pouvoir procéder dans les règles.
L’obligation, aussi, de devoir faire appel à leur réseau personnel pour effectuer les injections de Laura, dans l’ombre. Non loin d’être infondée, cette peur s’explique par la double conséquence que peut entrainer l’illégalité. Tout d’abord, le personnel soignant encourt de gros risques. Exerçant hors du cadre légal de leur travail, les personnes concernées peuvent se faire radier. Laura et Caroline ont donc toujours redoublé d’efforts pour ne pas les mettre en danger. Ensuite, parce qu’en cas de dénonciation, Laura était susceptible de perdre définitivement ses droits de sécurité sociale, et de devoir rembourser la totalité des traitements prescrits, s’élevant à des sommes monumentales. Malgré leur approche optimiste, la peur restait omniprésente et le poids du secret permanent.

La contrainte de l’illégalité ne s’arrête pourtant pas là. Elle peut aussi mener la personne enceinte à se mettre en danger, par peur de faire appel aux soins. L’expérience de Laura et Caroline en est une illustration criante. Suite à une forte stimulation, elles se sont rendues en Espagne pour la ponction. La veille, Laura avait le ventre anormalement gonflé et ressentait d’atroces douleurs. Arrivées dans la clinique espagnole, la ponction se déroula sans encombre. On annonça pourtant à Laura dès son réveil d’anesthésie générale, qu’elle ne pourrait pas faire le transfert dans les jours suivants, comme le voulait la procédure habituelle. Elle était en hyperstimulation, trop sujette à d’éventuelles complications. Il n’était pourtant pas question de prendre en charge ses douleurs, on lui répondit simplement : « Prenez de l’Efferalgan et rentrez chez vous en France. » À leur retour, les souffrances physiques amplifièrent. Laura me confie : « J’étais dans un état piteux, j’avais des douleurs inimaginables, je ne pouvais pas descendre un escalier. Même l’accouchement en comparaison, c’était rien. » Elle attend tout de même 48 heures, et se décide à appeler le SAMU. Caroline s’inquiète sérieusement pour la santé de sa femme. Par chance, Laura tombe sur un homme à qui elle semble pouvoir faire confiance, et lui dit la vérité. Le soignant lui explique : « Vous êtes en hyperstimulation, c’est grave. Il faut que vous restiez allongée et buviez beaucoup d’eau. Par contre, si une douleur aux poumons ou à la poitrine survient, c’est que vous faites un début d’embolie pulmonaire. Il faut vite aller aux urgences. » Le lendemain, Laura se couche avec de très fortes pointes dans les poumons. Sans hésiter, Caroline attrape le sac qu’elle avait préparé, et l’emmène aux urgences.
Arrivées à l’hôpital, le ventre de Laura est si gonflé que le personnel soignant pense d’abord qu’elle vient pour accoucher. On découvre après une échographie qu’elle a sept litres d’ascite dans le ventre. Elle venait de faire un changement hépatique, et avait un début d’embolie pulmonaire. Ne suivant pas officiellement un parcours PMA en France, Laura n’était pas couverte et ne pouvait pas officiellement être traitée dans le service approprié. Par chance, quelques internes décidèrent de la cacher dans un autre service. Celui des suites de couche. Laura, en situation de santé dégradée, et ayant appris avec dépit qu’elle devait encore attendre pour avoir son futur bébé, se retrouva donc dans le service de personnes qui venaient d’enfanter. Elle fut cependant prise en charge pendant une semaine, au cours de laquelle le service de PMA venait lui donner ses médicaments et vérifier son état de santé en catimini. Malgré toute sa reconnaissance envers le personnel hospitalier, Laura se rendit à l’évidence : elle s’était mise en danger par peur de la dénonciation, par peur de devoir rembourser les 8500 euros de prise en charge que coûtait une telle hospitalisation. « Les jeunes internes ont été géniales. Ca les embêtait que le système m’empêche d’avoir accès aux soins. Parce que si j’avais été suivie en France, je ne serais jamais arrivée à ce stade, j’aurais été prise en charge beaucoup plus tôt. Mais en Espagne, iels s’en foutaient de mon état, et moi en France j’ai eu honte, et peur d’aller vers le soin. J’ai attendu que ce soit inévitable, et je me suis mise en danger. »
Cette illégalité est un incessant fardeau, qui construit la pré-grossesse dans l’anxiété. Laura me fait part de cette insupportable difficulté : « Le fait d’avoir cette crainte permanente, ça ne permet pas un parcours zen et détendu. On avait toujours peur. L’argent n’est rien à côté de l’illégalité. Tu ne peux pas aller sans réfléchir ni stresser à la pharmacie chercher un traitement, et tu dois mentir lorsqu’on te pose une question. Le fait de mentir m’a amenée à me sentir honteuse, à avoir l’impression de faire quelque chose de mal. Mais je ne faisais rien de mal, simplement un enfant avec ma femme. » Rebondissant sur les paroles de Laura, Caroline me fit part de cette peur partagée : « C’était compliqué pour tout. On allait chez le même biologiste, on avait désormais le même nom de famille, qu’est-ce qui s’envisageait, qu’est-ce qui se disait ? De même à la pharmacie, où on nous connaissaient… Par exemple, le premier soir où Laura est restée à l’hôpital après son embolie pulmonaire, j’ai fait un saut à la maison pour récupérer des affaires. J’avais aussi une ordonnance, avec des médications à récupérer pour Laura. Et je me souviens, je suis arrivée à la pharmacie, je n’avais pas dormi de la nuit. J’ai posé sa carte vitale, sa carte de mutuelle, l’ordonnance, et j’ai bafouillé : « Je ne sais pas ce que je dois faire. » J’étais désorientée. Ce n’était pas mon prénom, je ne savais pas ce que je devais dire. J’ai prétexté être là pour une amie, mais ça n’avait aucun sens. Iels me connaissaient et iels savaient que j’étais avec Laura. Et en même temps… je ne pouvais pas le dire. C’était hyper gênant, et terriblement stressant. »
Cette inégalité face aux droits des couples hétérosexuels, Laura et Caroline l’ont une fois de plus ressentie à la naissance de leur fille, Louison. Cette dernière eut une clavicule cassée au cours de l’accouchement, elle dut donc être déplacée dans un autre bâtiment pour une radio. Laura n’était pas en état de faire le déplacement, elle venait d’accoucher. Elle proposa que sa femme s’y rende, mais c’était impossible. Caroline n’avait aucun droit sur Louison, elle ne pouvait pas l’accompagner. Pour ne pas laisser leur fille toute seule, Laura fut donc obligée d’aller à l’autre bout de l’hôpital, perdant des caillots de sang et peinant à marcher. Si Caroline avait été un homme, elle aurait pu y aller sans aucun problème.
Dans la même logique, Caroline, qui n’avait aucun droit de parentalité à la naissance de sa fille, ne pouvait officiellement pas prendre les onze jours de congés accordés normalement au père. Par chance, sa hiérarchie fut d’un grand soutien et lui a accordé quelques jours avec sa famille. Mais comme me l’explique bien Laura, sans le soutien de plusieurs personnes dont la bienveillance admirable dut souvent emprunter des chemins illégaux, leur parentalité aurait été impossible : « Si le projet a marché, c’est grâce à des gens qui ont été hors-la-loi. Par exemple, ses collègues étaient hors cadre de la loi du travail, le gynécologue aussi. Mais avec du bon sens et des gens soutenants, on a réussi à le faire, et que ça se déroule bien. »
Des prédispositions avant et après la naissance
Le mariage et la paperasse comme moyens d’accéder à la parentalité
En portant l’enfant, Laura était automatiquement sa mère aux yeux de loi. En revanche, Caroline n’aurait aucune filiation avec lui. Laura m’explique : « S’il m’arrivait quoi que ce soit, si par exemple je décédais en couche, ou si on avait une dispute des plus violentes avec Caro, elle n’avait aucun droit légal sur cet enfant. Alors que j’avais tous les droits. » Pour éviter cette horrible éventualité, Caroline avait pour seul choix de déposer une demande d’adoption. Pour ce faire, elles devaient prouver qu’elles étaient en couple depuis longtemps. Un couple solide. En six mois, elles ont décidé de se pacser, puis de se marier. Pour l’une comme pour l’autre, le mariage fut impulsé par leur désir de maternité. Laura avait envie de se marier, mais ne ressentait pas le besoin de le faire à ce moment-là, quant à Caroline, l’idée du mariage ne correspondait pas à son idéal, car il était trop normé. Cependant, leur choix fut rapidement fait.
Comme me le confie Laura, le projet était la meilleure raison de s’unir : « C’était une manière de combler cette attente du bébé. Je savais que je le faisais pour lui, donc c’était beau. » Elles ont ensuite dû accumuler toutes les preuves de leur amour : « Dès ce moment-là, on a gardé une trace de tout, depuis le début de notre rencontre. Afin de prouver notre solidité. Parce qu’on nous avait préparées à tout ce qu’il se passe après le bébé. On a fait tout notre possible pour multiplier les chances. » À la fin du premier trimestre de grossesse, le couple a aussi effectué des démarches administratives. Une étape supplémentaire pour se prémunir contre l’absence de parentalité officielle de Caroline. Laura déposa donc un testament officiel auprès d’un notaire, stipulant son souhait que Caroline puisse adopter son enfant.
« Mériter » le droit à la parentalité
Lors de leur mariage, il fut convenu que Laura prendrait le nom de famille de Caroline. Cette décision était réfléchie : Laura donnerait à Louison ses gênes, Caroline lui transmettrait son nom. Elles portaient donc toutes les deux le nom de famille de Caroline lorsque Louison est née. Deux raisons auraient pu permettre à leur fille de porter ce même nom : le fait que Caroline soit reconnue comme parent légitime, ou le fait que le mariage de Laura lui donne le droit d’enfanter. Or, aux yeux de la loi, aucune de ces deux possibilités n’était recevable. À sa naissance, Louison portait donc le nom de jeune fille de Laura. Comme me l’explique Caroline : « Ce sont les restes de la société traditionnelle chrétienne française : une femme mariée ne peut avoir d’enfant qu’avec son mari. Il est donc automatiquement reconnu comme père. Mais s’il n’y a pas de conjoint masculin, c’est comme si la mère avait fait un bébé toute seule. » Laura et Caroline avaient donc un nom de famille différent de leur fille. Elles savaient que les choses se dérouleraient ainsi. Elles s’étaient préparées. Mais échapper à la mauvaise surprise ne suffit pas à combler la violence de ne pouvoir transmettre son nom.
Pour écourter ce temps, Laura déposa dès la naissance de leur fille un acte stipulant son accord concernant la demande d’adoption de Caroline. Les démarches chez le notaire furent coûteuses, et obligèrent aussi le couple à effectuer de pénibles procédures, comme le testament. S’ensuivirent deux mois d’attente, qui représentent le délai légal de rétractation. Caroline n’avait donc toujours aucun droit sur leur enfant, elle me parle de cette pénible période : « Laura aurait pu partir avec Louison à l’autre bout de la France, changer de nom et vivre une nouvelle vie. Je n’aurais eu aucune légitimité à revoir ma fille. ».La confiance devait donc être totale. Laura me livre aussi la complexité de sa place : « Je ne voulais pas avoir une telle ascendance sur Caro. Je me disais : « Si elle fait un truc qui me blesse énormément, qui me donne envie de la quitter, est-ce que je vais être assez forte pour mettre de côté notre couple ? » Je sais que je ne l’aurais jamais fait, mais je savais par exemple que Caroline ne prendrait pas le risque de me quitter durant la première année, même si elle en avait eu envie. Avoir un tel pouvoir, c’était dur à porter. »
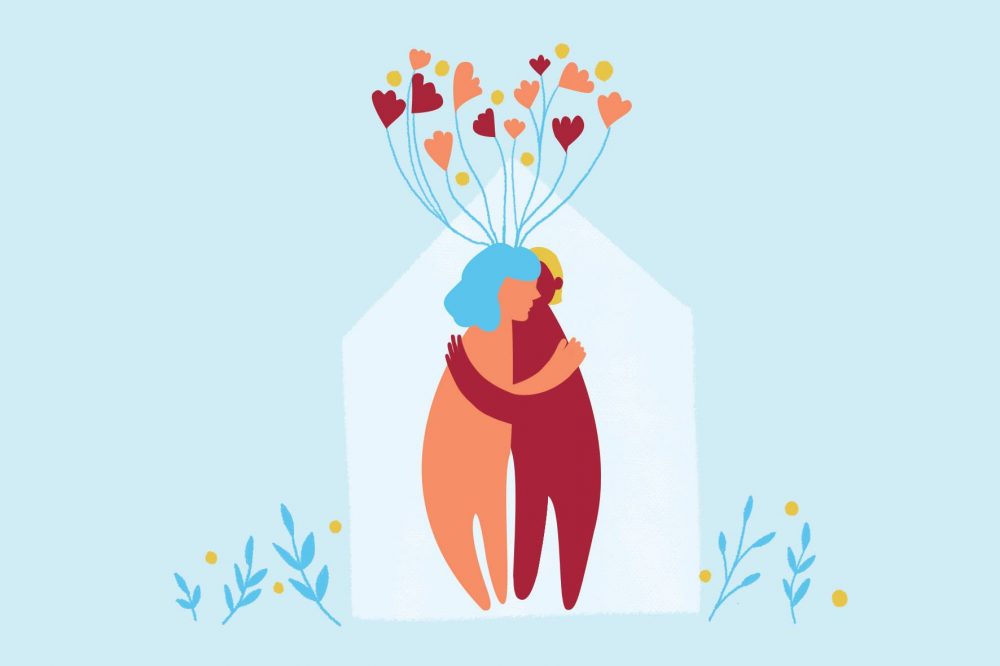
Lorsque Louison eut six mois, Caroline pu enfin déposer un dossier de demande d’adoption plénière au tribunal. Elles ont donc dû réunir un maximum de documents prouvant que Caroline était une bonne maman. Des photos à l’appui, une lettre de motivation, puis une synthèse de cette dernière. Caroline me raconte s’être retrouvée déconcertée devant la question « Pourquoi choisissez-vous d’adopter cet enfant ? » Ayant déjà rempli un dossier entier à ce sujet, elle disposait de quatre lignes pour répondre à cette vaste interrogation. Elle se rappelle avoir eu envie d’écrire : « Parce que c’est mon enfant, je suis là depuis le début… » Devoir justifier sa place est très difficile, lorsqu’on a désiré son enfant autant que la mère biologique : « C’était tellement évident, je ne savais plus quoi dire. C’était super bizarre, je devais me justifier, justifier ma place. Je ne me posais pas la question de pourquoi, la réponse était claire : « parce que je suis la maman, tout simplement ! » »
Une fois le dossier déposé, les délais sont très longs, environ neuf mois, « une deuxième grossesse », comme le dit si justement Laura. Caroline était stressée à l’idée de passer devant un juge. Finalement, l’audience a duré un quart d’heure, avec des questions telles que : « Pourquoi choisissez-vous d’adopter l’enfant ? », « Où est le père ? », « Est-ce que l’enfant a des repères masculins autour de lui ? » Très entrainée, Caroline sut parfaitement quoi répondre. Parmi les innombrables critères, un seul avait échappé au couple : elles devaient être mariées depuis plus de deux ans, ou avoir 28 ans révolus. Le jour de l’audience, elles avaient moins de 29 ans et étaient mariées depuis un an, onze mois et une semaine. Une fois de plus, c’est grâce à l’altruisme et l’astuce que les choses se déroulèrent sans encombre : le juge ne prit pas immédiatement sa décision, pour la valider trois semaines plus tard, soit deux ans après le mariage de Caroline et Laura. Suite à cela, il restait les dernières démarches administratives : refaire la pièce d’identité, l’acte de naissance et le livret de famille de Louison, modifier son nom sur tous les papiers.
Un an et deux semaines après la naissance de Louison, Caroline fut enfin soulagée : elle était officiellement la mère de sa fille.
Des freins idéologiques
L’entourage
Laura et Caroline ont eu la chance de ne pas subir d’avis défavorable concernant leur projet de parentalité. En couple depuis cinq ans lorsqu’elles ont annoncé à leurs proches la maternité de Laura, elles s’étaient depuis longtemps éloignées des personnes potentiellement homophobes. Leur entourage bienveillant fut donc agréablement surpris, ayant parfois fait le deuil de leur maternité respective.
Un corps médical pas toujours bienveillant
Après la naissance de Louison, Caroline et Laura se sont relancées dans l’aventure PMA afin de donner naissance à un autre enfant. Quelques jours avant un voyage à Cuba, Laura eut besoin d’un traitement en urgence, en lien avec sa deuxième PMA. Son gynécologue était temporairement absent. Elles décidèrent alors de se rendre chez leur médecin traitant. Hésitante, Laura finit par oser lui demander ce dont elle avait besoin. Le médecin montra immédiatement sa désapprobation. Il se recula sur son siège, pour leur rétorquer : « Je suis désolé, mais je ne cautionne pas votre projet. Je ne suis pas pour, parce que je suis convaincu et persuadé qu’un enfant a besoin d’un papa pour se développer correctement. » Le couple se trouva désarmé. Le médecin connaissait leur fille, il la soignait fréquemment. Laura et Caroline m’expliquent à l’unisson qu’elles auraient compris un refus causé par l’illégalité. Elles auraient accepté cet argument. En revanche, elles estiment que de tels propos n’ont pas leur place dans un cabinet médical. Il s’agit d’une opinion personnelle, et non d’un diagnostic. Le docteur finit par remplir une ordonnance, sur laquelle il prit le soin de noter à côté de chaque traitement « NR », soit « Non remboursé ». Le prix de chaque injection s’élevant à 100 euros, inutile de préciser que le couple eut du mal à avaler la pilule. Et le médecin ne s’arrêta pas en si bon chemin. Caroline me décrit, en vivant une seconde fois la scène : « Il nous a dit : « Je ne comprends pas, vous avez déjà mis combien d’argent ? », je lui réponds : « beaucoup » et il me déclare : « Il me semble donc que vous n’êtes plus à ça près, et que pour avoir votre enfant, il faut aller au bout de la démarche. » C’était très violent. »
Cette expérience ramena une énième fois Laura à la honte : « Chez le médecin, j’ai une forme de respect. Et j’avais honte de me dire : « Mais en fait, lorsqu’il voit Louison, il la plaint, il trouve qu’elle va mal, qu’elle est malheureuse ? C’est avec ce filtre-là qu’il la regarde ? » C’est ça qui m’a fait violence, pas la critique de notre projet. Je n’ai pas envie que quelqu’un la regarde comme ça. Ma fille va bien, elle est heureuse. » Laura et Caroline ont donc changé de médecin suite à cet événement douloureux. Laura m’explique avoir explosé en sanglots en pleine consultation lorsque sa nouvelle docteur accepta de la suivre.
Endosser une place marginalisée dans la société
Le poids de l’homophobie est malheureusement encore bien lourd. Impliquées dans le combat pour l’égalité de tou·te·s devant la loi, Caroline et Laura ont participé à plusieurs manifestations pour la légalisation du mariage homosexuel. Non sans douleur, elles ont été habituées à subir l’agressivité des CRS. Mais encore plus pénible que cette forme de violence, il y a les agressions strictement homophobes : « Une fois on s’est faites gazer alors qu’on n’était pas dans la manifestation. On se tenait la main dans la rue, pas loin d’une manif, et un homme a foncé sur nous pour nous gazer en plein visage. Juste parce qu’on se tenait la main. Et ça… je m’en souviens bien plus que les manifs, parce que c’était dirigé contre nous deux. Le même soir, les yeux encore irrités, on est allées à une soirée chez une copine. Il y avait plein de gens qu’on ne connaissait pas. Je me suis retrouvée face à un type qui m’a tenu tête pendant des heures, me disant que l’homosexualité était une maladie. »
Malgré les mauvaises expériences de ce genre, le couple reste positif. Elles considèrent toutes les deux que la France progresse vers plus de tolérance. Du reste, elles se protègent comme elles peuvent, car « il en est ainsi aujourd’hui ». Laura et Caroline se savent bien entourées. Leur fille est aimée par leurs proches comme n’importe quel enfant. Laura conclut ainsi : « J’espère que cet amour lui permettra de se sentir protégée, et soutenue, de la même façon que nous l’avons été. »
Et maintenant ?
Pour le couple, il ne doit y avoir aucun tabou concernant la conception de leur enfant. Afin de pouvoir lui expliquer leur démarche, puis être capables d’en discuter ensemble, Caroline a créé un livre retraçant l’histoire de Louison. Elle me montre avec fierté et émotion un gros album blanc et bleu au format A4, dans lequel sont épinglées toutes sortes de photographies, souvenirs et reliques du chemin parcouru. Des images du couple amoureux, de leurs familles respectives, de leurs amis, puis de la naissance de Louison, de leur premier voyage toutes les trois. Pour Caroline, il était essentiel d’en parler ouvertement, et ce dès le plus jeune âge : « Ce livre est une façon de lui expliquer, de tout lui raconter. Déjà quand elle était dans le ventre de Laura, je lui parlais souvent, je lui expliquais pour quelles raisons on avait eu envie de l’avoir. »
Maintenant que leur fille est née, les deux mères mettent un point d’honneur à en parler de façon hebdomadaire. Elles privilégient une parole libre, pour se prémunir d’une perte de repère chez Louison. Caroline me livre sa façon de penser : « Par la communication enthousiaste, on peut éviter qu’elle vienne nous voir à dix ans en nous demandant : « Mais pourquoi vous ne m’avez jamais dit que je n’avais pas de père ? » ou encore : « Il est où mon père ? Je veux le retrouver. » »
De ce long chemin ressort finalement de la fierté chez Laura, et du soulagement pour Caroline. Toutes deux sont heureuses d’avoir réussi, heureuses de pouvoir, enfin, être mères comme tout le monde. Caroline déclare : « Pour la première fois, on est à un stade normal. On est comme tous les autres parents, maintenant. » Elles souhaitent continuer à éduquer leur fille, afin de lui transmettre leurs valeurs. Elles espèrent lui permettre d’acquérir une grande ouverture d’esprit, et qu’elle comprenne leurs choix. Malgré toutes ces épreuves, elles retiendront surtout l’entraide extérieure et leurs capacités personnelles à se soutenir : « On a vraiment porté tout ce projet ensemble, toutes les deux. Beaucoup de gens ont aussi été fantastiques et notre entourage nous a beaucoup aidées. »
Aujourd’hui, Caroline et Laura ont réitéré le parcours de PMA espagnol. Grâce aux embryons congelés, Louison pourrait bien avoir un petit frère ou une petite sœur d’ici quelques mois. Bravant une seconde fois cet Everest, elles ne pensent pas à la montagne de démarches et aux multiples difficultés, mais au bonheur de l’arrivée d’un deuxième enfant. Au bonheur de voir leur fille grandir, et d’agrandir leur famille.




Très émouvant, même si on connaît le parcours des 2 mamans…
J’ai un feuilleton à proposer à votre magazine, féministe et scientifique. Si l’idée d’offrir ces épisodes à vos lectrices et lecteurs, faites-le moi savoir. Ce serait un plaisir !