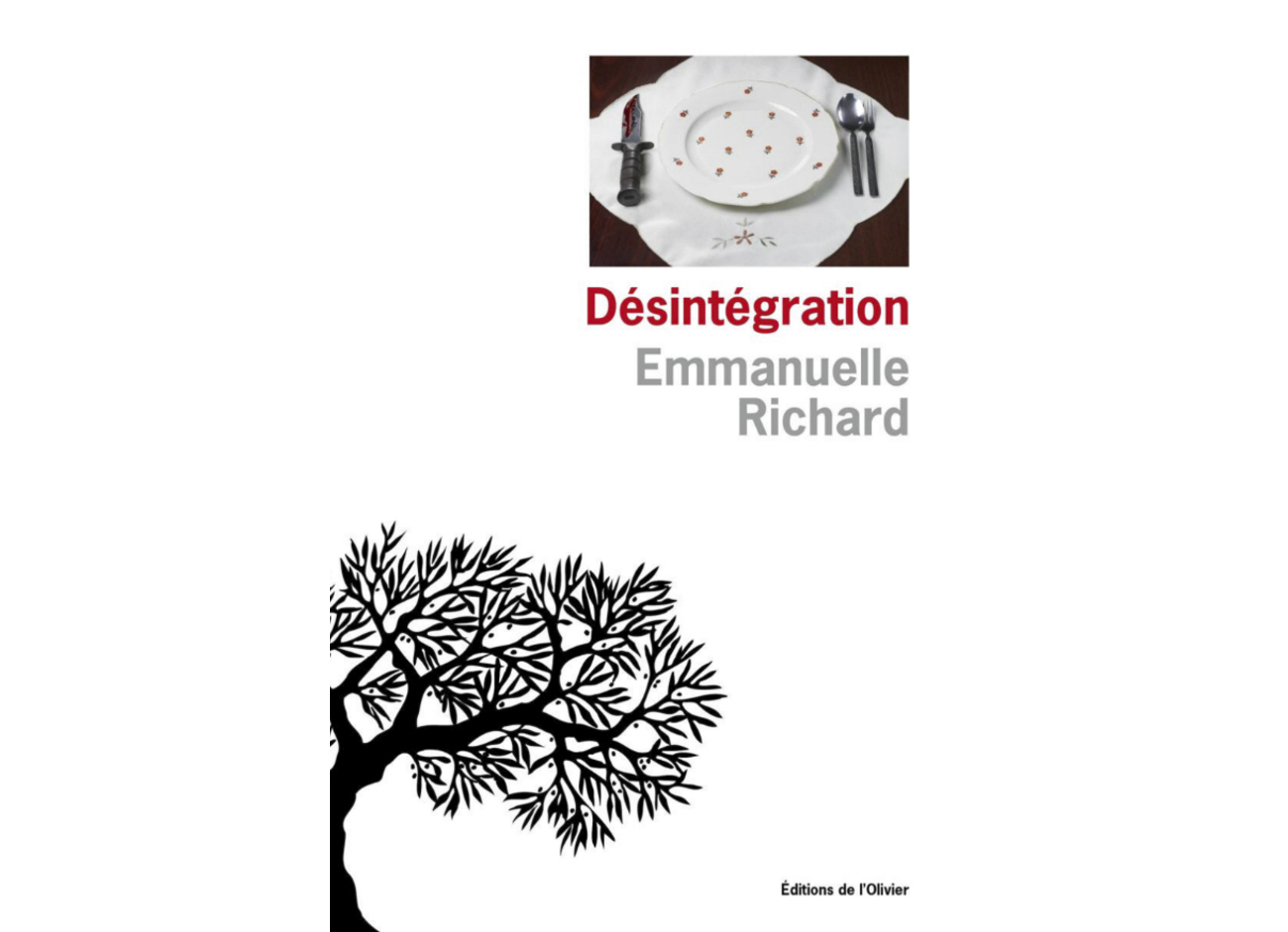« Désintégration », le dernier roman d’Emmanuelle Richard, est sorti en août 2018. Un appel vibrant à la révolution, au renversement du système capitaliste, avec en toile de fond un Paris fait par et pour les riches. Un roman qui se lit d’une traite et qui fout la haine.
C’est l’histoire d’une tentative d’ascension sociale à laquelle la protagoniste elle-même ne croit pas vraiment. Après quelques essais dans des grandes villes (Bordeaux, Toulouse), elle atterrit à Paris, des plans et des idées plein la tête, à la façon d’un Lucien Rubempré ou d’un Rastignac. Mais à la différence de ces deux héros de Balzac dans La Comédie humaine, qui peuvent compter sur de nombreux soutiens provenant directement du milieu, personne ne va l’aider, personne ne va lui expliquer les codes du milieu bourgeois. Elle va tout apprendre toute seule, mais en vain, ou presque.
Ce roman est traversé par la haine, ce sentiment dont il est tant question en ces temps troublés. La haine à l’égard de la bourgeoisie et de chacun·e de ses membres, qui se développe au fil des années et des pages.
« Bons à rien de bourgeois. Un flash d’ultraviolence me télescope. Le mépris alors qu’ils sont pour si peu dans ce pour quoi ils se sentent supérieurs. Le mépris éhonté, infériorisation et hiérarchisation de toutes les autres strates et sur tous les sujets, suffisance. Pilonner leurs dents saines. En scier les racines. Écraser leurs petites gueules imbues sur un coin de trottoir ou une arête de mur du bout de ma chaussure. Arracher des oreilles. Je ressens une bouffée de haine pure. »
C’est aussi l’histoire d’un renoncement. Au début elle veut tout obtenir : le capital économique, le capital culturel, l’aisance dans les rapports sociaux. Tout. Mais plus le temps passe plus elle renonce à tous ses rêves d’intégration dans ce milieu social si différent de son milieu d’origine – que l’on pourrait qualifier de petite classe moyenne.
Il n’y a qu’un rêve qu’elle n’abandonne pas, peut-être ne serait-ce que parce que sans ça elle n’aurait plus aucune raison de vivre : publier un livre, son livre, celui qu’elle mûrit dans sa tête tout au long de ces années parisiennes, passées à étudier la littérature la journée, à cumuler et à changer de jobs alimentaires le soir. S’il lui reste une heure en rentrant, elle écrit.
« Je ravalai mes ambitions comme une vieille morve. Je ne croyais plus qu’il était possible de tout gagner à la force du poignet lors que l’on voulait beaucoup. […] La honte gagna et devint mon état permanent. J’avais perdu mon combat avec elle. J’avais eu beau savoir, dans une autre vie, que je n’étais pas intrinsèquement inférieure, ça ne changeait rien. Je ne ressentais plus que ça, atteinte en continu quel que soit l’endroit. Elle était moi et j’étais elle. »
En parallèle, on a le récit de sa rencontre avec un « grand intellectuel », à qui elle envoyé son livre dédicacé, comme elle l’a fait pour d’autres personnalités du monde de littéraire et artistique. Elle n’a jamais vu un seul de ses films, il l’invite à dîner, ces deux-là n’ont rien à se dire mais passent la soirée ensemble. On comprends donc que le fameux livre a fini par être publié. Mais la protagoniste n’a pas l’air heureuse (ni riche) pour autant. Tout cela ne servirait-il donc à rien ? À quoi bon se battre ? Qu’est-ce qui fait tenir, à part la haine des dominant·e·s et l’espoir de voir un jour peut-être son rêve le plus cher se réaliser, même s’il ne change pas foncièrement sa situation ?
Ce roman est en quelque sorte la fictionnalisation des théories de Bourdieu : les rapports de domination, la haine de classe, la honte sociale, le concept de capital (économique ou culturel). On se met à détester la bourgeoisie, encore plus fort ou de nouveau, en fonction de notre situation en tant que lecteur·trice. La lutte des classes n’est pas un concept poussiéreux, le problème est toujours là, les inégalités ne cessent de se creuser, ce livre s’en fait l’écho.
Cette narration au rythme qui alterne, entre phrases courtes ou longues, explicatives ou violentes, nous prend aux tripes, ne nous lâche pas, et sert parfaitement le propos.
Et puis il y a même une approche intersectionnelle : comment est-on considérée lorsqu’on est une jeune femme qui ne vient pas de la bourgeoisie ? En quoi la situation des personnes racisées de cette classe sociale-là est-elle encore plus empreinte de souffrance, encore plus compliquée que lorsqu’on est blanc·he ?
« Un après-midi, je passai un entretien d’embauche […]. C’étaient deux Maghrébines qui le menaient. […] Elle me laissa m’humilier à lui raconter mon parcours dans le vent. […] Elle avait un compte à régler, j’étais la bonne personne pour ça. Ça n’avait rien à voir avec moi. J’étais une yeux bleus à la peau de Javel, mon patronyme avait une consonance franco-française de souche. Je restais du côté de la force quel que soit le verdict de ma réussite économique. Je n’aurais jamais de mal à franchir la première étape qui mène à l’emploi ou à la location immobilière, soit jamais de difficulté pour obtenir le moindre entretien. Je ne saurais jamais ce que c’est d’être suspectée d’emblée sous prétexte d’une origine géographique qui remontait à plusieurs générations avant moi […]. »
Bref, notre société a plus besoin d’Emmanuelle Richard que de Michel Houellebecq.